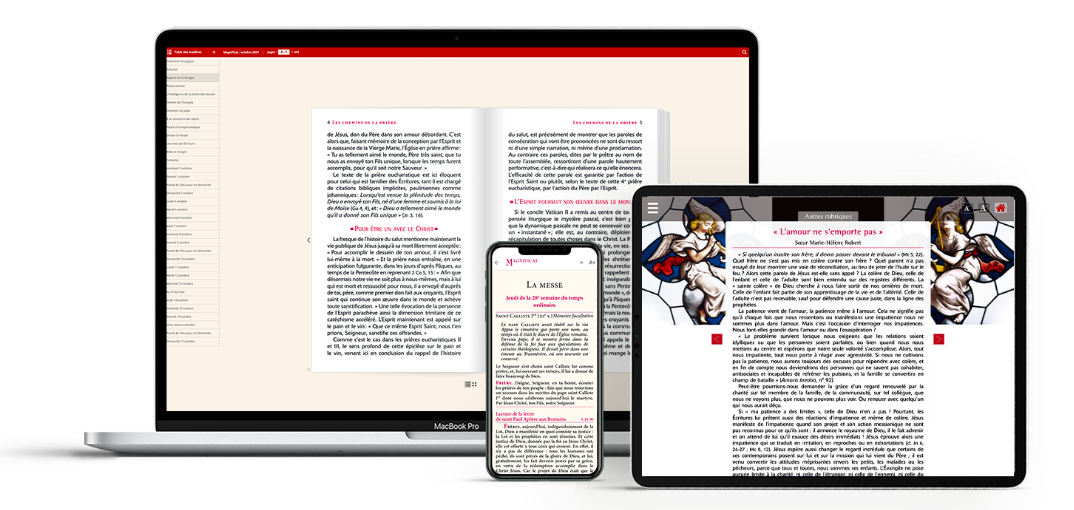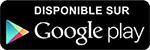Rejoignez la grande prière de l'Église
Magnificat est une revue mensuelle qui vous accompagne chaque jour sur le chemin de la prière de l’Église, et vous aide à développer votre vie spirituelle selon votre vocation propre.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 7-14

Rejoignez la grande prière de l'Église
Magnificat est une revue mensuelle qui vous accompagne chaque jour sur le chemin de la prière de l’Église, et vous aide à développer votre vie spirituelle selon votre vocation propre.
CE MOIS-CI
avril 2024
Ce mois ci
dans Magnificat

Commentaire de couverture

Œuvre d'art du mois
POUR ALLER PLUS LOIN
Coin prière de Magnificat

En savoir plus
Coin prière
Partagez ici vos intentions de prière et portez celles des autres.
Prier Dieu - Prières à Marie - Prier avec les saints - Prier en toutes circonstances - Prière de l'Église
Retrouvez une sélection thématique d'articles publiés dans Magnificat.
LIRE
Magnificat en ligne
L’édition numérique de Magnificat est disponible sur tous les supports en ligne et sur l’application. Elle est gratuite pour les abonnés papier.
MAGNIFICAT
A votre service

Trésors de la rédaction
Retrouvez une sélection thématique d'articles publiés dans Magnificat